
Programme du séminaire 2025-202605/02/2025
Mouvements contre-hégémoniques et mutations du capitalisme à l'âge des Big Tech
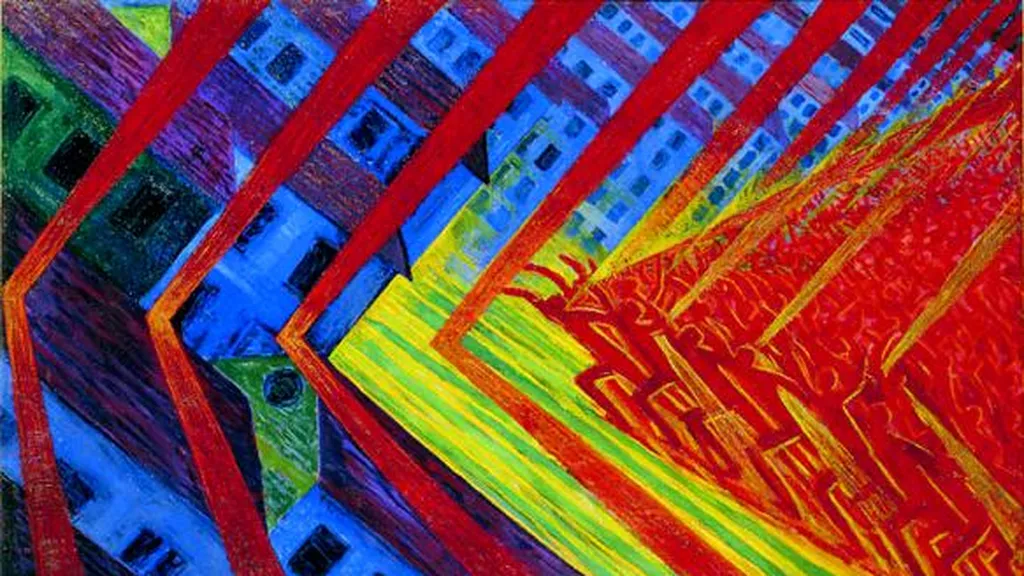
Texte de l'intervention de Ludovic Bonduel au séminaire « Capitalisme cognitif » du 14/06/2023
Télécharger l'article au format pdf
Bonjour à tous,
Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer dans ce séminaire. C’est probablement un des lieux les plus propices pour discuter les enjeux de la divergence entre les théories du commun comme mode de production et du commun comme principe politique. Ce débat est au cœur de la thèse de théorie politique que j’ai soutenu au mois de janvier.
La notion de commun(s) connait un succès militant et académique dans de nombreux pays depuis les années 1990. Cela tient d’abord aux travaux d’Elinor Ostrom (en particulier de son livre « Governing the Commons » de 1990), qui ont montré que des ressources naturelles peuvent, dans certains cas, être gérées de façon efficace et durable par des communautés locales, plutôt que par l’Etat ou le marché.
Cela tient également à l’essor des communs numériques, qui a accompagné l’ouverture du web au grand public, la diffusion des ordinateurs personnels et de l’accès à internet dans la société. Avec le succès retentissant de différents logiciels libres ou de wikipedia, on a constaté que des milliers de gens pouvaient collaborer pour produire des biens informationnels de très haute qualité, de façon non-hiérarchique, non-propriétaire, et non-marchande. Enfin, la notion de communs s’est aussi développée dans le cadre du mouvement altermondialiste, pour lutter contre les privatisations néolibérales sans en appeler à l’Etat et la propriété publique.
En effet, parler de communs, c’est avant tout chercher à penser au-delà d’une alternative binaire entre Etat et marché, propriété publique et propriété privée, pour penser des modes démocratiques d’appropriation et de gouvernance des ressources.
Les communs, au pluriel, sont des espaces institutionnels construits autour de la gestion collective d’une ressource par une communauté. Un commun comprend donc une communauté, une ressource, et un ensemble de règles permettant à la communauté de gérer la ressource.
Au-delà de la notion de communs au pluriel, différents auteurs ont développé la notion de commun au singulier, pour cerner la logique commune à l’ensemble des communs. Le commun au singulier, a été théorisé d’une part, comme un mode de production par des auteurs post-opéraïstes : d’abord Michael Hardt et Antonio Negri, puis les organisateurs de ce séminaire (Carlo Vercellone, Alfonso Giuliani, Francesco Brancaccio). Le commun au singulier, a d’autre part été théorisé, par Pierre Dardot et Christian Laval comme un principe politique.
Dans ma thèse, j’insiste sur l’opposition entre ces deux approches, je la mets en scène, la dramatise un peu pour défendre la théorie du commun comme principe politique.
Aujourd’hui, j’ai certains doutes et ma réflexion a un peu évolué, notamment en lisant le très bon livre écrit par les organisateurs de ce séminaire et intitulé : « Le commun comme mode de production ». Je commence à me demander s’il ne serait pas plus constructif de dé-dramatiser cette opposition et de travailler à partir des points forts des deux approches.
Je vous propose donc d’organiser ma présentation en deux temps. D’abord, je vais vous présenter certains éléments clés de ma thèse de doctorat, en particulier la critique des théories du ou des communs comme mode de production que je formule. Ensuite, je vais essayer de dé-dramatiser l’opposition et de voir dans quelle mesure il serait possible de faire dialoguer ces approches.
En somme, je commence par dramatiser l’opposition, avant de la dé-dramatiser.
(A) Problématique de ma thèse et typologie des théories
Dans ma thèse, j’interroge les différentes théories des ou du commun en portant une attention particulière à la façon dont elles conçoivent le rapport entre politique et technique.
Je me demande quelles sont les différences entre les théories des communs et leurs façons de concevoir le rapport entre politique et technique. De façon plus normative, je me demande comment doit-on penser les communs, le commun et le rapport entre politique et technique ? Ce que j’appelle une conception particulière du rapport entre politique et technique, renvoie au fait de prendre position dans au moins un des trois débats suivants :
Ce débat porte sur le rôle que joue le développement technique dans l’histoire : dans quelle mesure le développement technique est déterminé par des choix sociaux, et dans quelle mesure l’évolution sociale est déterminée par le développement technique ?
La question ici est celle du pouvoir des experts dans les sociétés modernes, et de sa légitimité.
Ce débat inclue aussi la question du productivisme, qui est très liée aux idées technophiles. La croyance dans les vertus du progrès technique pousse souvent à penser que celui-ci pourrait réconcilier la croissance économique et la préservation de l’environnement.
A partir de là, je propose une typologie des différentes théories des communs, en les divisant en trois grandes catégories : les théories libérales des communs, les théories des ou du commun comme mode de production, et la théorie du commun comme principe politique. Je précise que cette typologie est inspirée d’un article de Carlo Vercellone et Alfonso Giuliani (2019).
Ce qui distingue les théories libérales des communs par rapport aux autres théories, c’est qu’elles ne sont pas anticapitalistes. Elles considèrent que les communs peuvent et doivent rester compatibles avec le capitalisme dans le cadre d’un ordre politique libéral. Aujourd’hui, je ne parlerai pas trop de ces théories, car ce sont les deux autres types de théories qui nous intéressent.
Les théories des communs et du commun comme mode de production s’inspirent toutes de la théorie marxiste de l’histoire, tout en la révisant. Elles considèrent que les communs sont la base d’un nouveau mode de production qui se développe au sein du capitalisme et pourrait le dépasser, de la même façon que le capitalisme s’était lui-même développé au sein des sociétés féodales. Cette analogie entre la sortie du féodalisme et la sortie du capitalisme est centrale dans la plupart de ces théories.
Enfin, la théorie du commun comme principe politique rejette la théorie marxiste de l’histoire et s’appuie à la place sur la philosophie de Cornelius Castoriadis. Elle définit le commun comme un principe politique qui caractérise les luttes sociales actuelles, et qui devrait inspirer une refondation complète des institutions économiques et politiques.
B) La critique Castoriadienne du marxisme
La critique du marxisme développée par Cornelius Castoriadis (1975) joue un rôle crucial dans ma thèse. Je m’appuie dessus pour critiquer les différentes théories des communs comme mode de production.
Castoriadis distingue deux éléments contradictoires chez Marx et dans le marxisme : un élément révolutionnaire et un élément déterministe.
L’élément révolutionnaire insiste sur la lutte des classes, appelle à transformer le monde plutôt qu’à l’interpréter, et affirme que les hommes font leur propre histoire bien que ce soit dans des conditions données. Cet élément pose l’objectif d’une transformation révolutionnaire de la société par elle-même.
Mais selon Castoriadis, ce qui domine dans le marxisme c’est le second élément, qui consiste dans une théorie déterministe de l’histoire. Cette théorie renvoie au schéma d’une infrastructure économique qui déterminerait la superstructure politique et légale. Et dans l’infrastructure économique, le véritable moteur de l’évolution historique est le développement des forces productives, c’est-à-dire, avant tout, le progrès technique appliqué à la production.
Avec cette théorie, on retrouve les trois débats que j’évoquais plus tôt. La théorie marxiste de l’histoire serait techno-déterministe, au sens où le progrès technique détermine l’évolution sociale.
Elle est technophile et productiviste, dans le sens où le développement des forces productives est associé à l’émancipation sociale.
Elle est aussi technocratique pour deux raisons. D’abord, parce que s’il existe une théorie complète et scientifique de l’histoire, alors le prolétariat doit suivre les experts de cette théorie plutôt qu’agir de façon autonome. Ensuite, parce que toute classe dominante (que ce soit la bourgeoisie ou la bureaucratie stalinienne) qui défend le développement des forces productives, joue un rôle progressiste : sa domination est donc légitimée au nom de sa contribution au progrès techno-économique.
C) Critique des théories du commun comme mode de production
Aujourd’hui, il est clair que plus grand monde ne reprend cette théorie de l’histoire telle quelle, sous sa forme vraiment déterministe, qui fait largement figure de repoussoir.
Les différentes théories des ou du commun comme mode de production s’inspirent à différents degrés de la théorie marxiste de l’histoire et la révisent de façon substantielle pour éviter ces aspects problématiques.
Pourtant, ce que je soutiens dans ma thèse, est qu’aucune d’entre elles n’échappe totalement à ces aspects problématiques.
Aujourd’hui, après avoir lu le livre des organisateurs de ce séminaire (« Le commun comme mode de production »), je dois avouer que ma critique ne s’applique pas très bien à leur théorie, qui échappe assez bien à ces problèmes – j’y reviendrai.
Je distingue trois types de théories des ou du commun comme mode de production, qui représentent trois perspectives différentes sur la sortie du capitalisme.
La première perspective, incarnée par Jeremy Rifkin, est techno-déterministe et apolitique. La seconde perspective est celle de Michel Bauwens et Vasilis Kostakis, elle est réformiste et modérément techno-déterministe.
La troisième perspective est celle de Michael Hardt et Toni Negri, elle est révolutionnaire et constructiviste.
Je vais développer successivement les principales critiques que je formule à l’encontre de ces trois perspectives.
1) Jeremy Rifkin
La théorie de Jeremy Rifkin est la moins subtile et la plus problématique. Selon Rifkin (2014), le progrès technique et en particulier le développement des outils numériques, va nécessairement conduire à une société post-capitaliste basée sur les communs. Le développement technique est autonome (il n’est pas orienté par les choix sociaux) et il est déterminant (il détermine l’organisation économique et sociale).
Durant les deux premières révolutions industrielles, le progrès technique conduisait de lui- même, nécessairement, à une société basée sur l’exploitation, les inégalités, le management autoritaire et vertical.
Mais heureusement, avec la troisième révolution industrielle, le progrès technique conduit à l’horizontalité, les communs, la collaboration ouverte etc. La théorie de Rifkin dissout complétement l’élément révolutionnaire du marxisme dans l’élément déterministe : la lutte de classes ne joue plus aucun rôle.
Cette théorie est donc déterministe et technophile, puisque le progrès technique amène l’émancipation sociale. Elle est aussi technocratique dans la mesure où la classe dominante joue un rôle progressiste : en favorisant le développement techno-économique, elle nous amène, sans le savoir, vers un future post-capitaliste.
2) Michel Bauwens et Vasilis Kostakis
Les travaux de la P2P Foundation sont très intéressants à de nombreux égards, mais je vais me concentrer ici sur ce qui me semble problématique dans leur approche théorique.
Le premier problème concerne le concept de pair-à-pair, qui est au cœur de leur théorie.
Je trouve que leur utilisation du concept est un peu trop large, floue et qu’elle crée une certaine confusion.
Ces auteurs définissent le pair-à-pair à la fois comme un type de relation sociale horizontale où des individus interagissent en réseaux, et les technologies numériques qui permettent à ce type de relation sociale de s’étendre aujourd’hui.
Le pair-à-pair serait aussi un synonyme du « commoning », de la « mise en commun », parce qu’il décrirait la capacité à contribuer à la création et la maintenance de ressources partagées. Selon eux, le pair-à-pair dépasse le monde numérique : ce serait le type de relations sociales dominant dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs.
Alors que le pair-à-pair ne pouvait s’appliquer qu’à petite échelle, les technologies numériques permettent de le faire passer à une échelle planétaire.
Mieux, avec les technologies numériques, le pair-à-pair devient hégémonique : « Nous partons de l’idée que les infrastructures pair-à-pair deviennent progressivement les conditions générales qui caractérisent le travail, l’économie et la société » (Bauwens & Kostakis 2014).
D’abord, je ne pense pas qu’il y ait vraiment lieu de parler de « réseaux » ou de « pair- à-pair » pour parler des bandes nomades de chasseurs-cueilleurs, ou même de toute relation sociale qui précède l’informatique en réseau. Le social ne se réduit pas à des réseaux interindividuels, il a une dimension collective, diffuse, anonyme : la métaphore du pair-à-pair me semble réductrice.
Ensuite, je trouve très trompeur l’idée que la société actuelle et ses infrastructures techniques se caractérisent avant tout par des réseaux horizontaux et décentralisés. Au contraire, on constate aujourd’hui, au cœur même de l’architecture d’internet un mouvement de recentralisation avec le Cloud.
Enfin, il y a une forme de déterminisme technique soft. La diffusion des technologies numériques serait le facteur déterminant pour comprendre les dynamiques sociales et économiques actuelles. C’est seulement grâce à elles qu’une alternative démocratique au capitalisme devient possible. Avant cela, les luttes anticapitalistes étaient nécessairement vouées à l’échec.
Un deuxième problème avec l’approche théorique de la P2P Foundation concerne le concept de « production entre pairs basée sur les communs » (commons-based peer production).
Pour eux, le nouveau mode de production post-capitaliste n’est pas le commun mais la production entre pairs fondées sur les communs, ce qui est beaucoup plus limité.
La production entre pairs renvoie à des formes d’organisation où des individus collaborent de façon flexible, sans permission, en réseaux, par la médiation d’outils numériques dont ils sont chacun propriétaire.
D’abord, la CBPP n’est concevable que dans un contexte où le capital fixe est largement distribué, où chaque individu possède ses propres moyens de production : PC, connexion à internet, imprimante 3D etc.
Les idées de la P2P Foundation se sont construites en partant de l’idée que les moyens de production informationnels et matériels devenaient largement distribués dans la société, que c’était une tendance de fond.
C’est largement une illusion. Il reste beaucoup de secteurs où le capital fixe est concentré et où les économies d’échelle sont cruciales. Doit-on abandonner le rail, les usines, le cloud, les mass médias, ou l’énergie à l'Etat et au marché ?
Ensuite, la production entre pairs met largement de côté les formes d’organisation un peu stables et formelles où les individus sont engagés durablement.
Enfin, la fascination pour la production entre pairs semble reposer sur une idée implicite : le meilleur antidote à la bureaucratisation est la dispersion des individus et leur collaboration en réseaux. Cela est très visible chez quelqu’un comme Dmitry Kleiner, qui promeut le « telekommunisme » qu’il définit comme « le communisme à distance ».
L’idée est que si le communisme se fait à distance, il sera démocratique et non bureaucratique. Il est pourtant absurde d’assimiler la distance et la démocratie.
Le dernier point que je voudrais soulever concerne dans une certaine mesure toutes les théories des ou du commun comme mode de production, même s’il prend une forme particulière chez Michel Bauwens et Vasilis Kostakis.
Ce point porte sur la validité du schéma marxiste de compréhension du changement historique à partir des contradictions entre développement des forces productives et rapports de production.
Pour aller vite, le développement des forces productives au sein d’un système social donné, finit par devenir incompatible avec les rapports de production dominants et leur traduction juridique en termes de propriété. Une classe montante, incarnant de nouveaux rapports de production, un nouveau mode de production plus propice au développement des forces productives finit par prendre le pouvoir et changer le droit.
Sur ce point, je m’appuie encore sur la critique de Castoriadis. Selon lui, ce schéma « représente une extrapolation abusive à l’ensemble de l’histoire d’un processus qui ne s’est réalisé que pendant une seule phase de cette histoire, la phase de la révolution bourgeoise » (1975, p. 27).
Ce schéma ne correspond pas du tout à l’effondrement du monde antique et l’apparition du monde féodal. Il ne décrit pas non plus l’industrialisation de la plupart des pays du Sud après 1945, qui a été faite par une bureaucratie communiste ou militaire, ayant pris le pouvoir après un coup d’Etat ou une guerre civile (Chine, Algérie, Cuba, Egypte).
Et pendant des millénaires, des empires et des civilisations se sont fondés puis écroulés sur la base d’infrastructures techniques et productives assez stagnantes.
Le schéma marxiste nous pousse donc à penser le dépassement du capitalisme par analogie avec le dépassement du féodalisme. Cela peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça limite notre imagination politique et stratégique. Chez Bauwens et Kostakis, ce schéma marxiste est repris dans un sens réformiste.
L’idée est que les révolutions sont le résultat de changements sociaux préalables. La révolution ne vient pas changer la société, mais elle résulte d’un changement de long cours, de la maturation progressive d’un nouveau mode de production.
Il faut donc remettre la révolution à plus tard, pour l’instant, l’important est de développement progressivement le nouveau mode de production. Cela rappelle l’argument de Karl Kautsky contre la révolution russe : les conditions objectives ne sont pas encore réunies. Je trouve que cet argument est difficile à tenir aujourd’hui.
3) Michael Hardt et Toni Negri
J’en viens maintenant aux œuvres de Michael Hardt et Toni Negri. Leur œuvre est très riche et elle mériterait une discussion beaucoup plus détaillée. Mais je vais me borner ici à soulever deux éléments de critique.
D’abord, je rejoins les critiques de Dardot et Laval sur la façon dont Hardt et Negri définissent le commun. Leur définition me semble trop vaste et imprécise.
Dans la préface de Commonwealth, Hardt et Negri disent que le commun désigne tout d’abord « la richesse commune du monde matériel – l’air, l’eau, les fruits du sol et toutes les libéralités de la nature ». Puis, ils ajoutent que le commun désigne surtout « ces résultats de la production sociale nécessaires à l’interaction sociale et à la poursuite de la production : les connaissances, les langages, les codes, l’information, les affects etc. ». Enfin, ils précisent que « cette notion du commun ne sépare pas l’humanité de la nature ».
Le commun est donc une sorte d’ontologie sociale et naturelle, qui inclue toute la nature, l’humanité, les productions culturelles de l’homme, et peut-être même ses productions matérielles.
Ce concept me parait donc un peu trop extensif.
Dans le livre « Le commun comme mode de production », j’ai l’impression que la notion de commun mobilisée oscille entre cette approche philosophico-ontologique très vaste, et une approche beaucoup plus précise.
Le commun est d’abord défini comme « l’activité socialement et historiquement déterminée qui produit constamment de nouvelles institutions, lesquelles sont à la fois les conditions et les résultats du ‘commun’ » (p. 58). A mon sens, le problème est que toute activité social-historique produit de nouvelles institutions : même celle des PDG du CAC 40 ou des militants d’extrême droite.
Un peu plus loin, le commun est présenté de façon plus précise comme « un principe général d’autogouvernance de la production et de la société », dont « le fondement réside dans l’autogestion de l’organisation du travail et dans l’inappropriabilité des principaux outils de production et des ressources » (p. 63).
Le deuxième élément de critique porte sur la façon dont Hardt et Negri reprennent et révisent la théorie marxiste de l’histoire.
Il est évident que leur approche n’a rien de technocratique ni de déterministe. Pour autant, je trouve qu’elle ne s’est pas vraiment dégagée d’un imaginaire technophile et même productiviste.
Ces auteurs ne proposent jamais de mettre des limites à l’expansion technologique, ils critiquent seulement la façon dont les techniques sont biaisées par le capital et le pouvoir.
Leur promotion du post-humanisme et de la figure du cyborg est aussi caractéristique d’un imaginaire très technophile.
Concernant le productivisme, j’ai des réticences par rapport au fait de critiquer le capital au nom du fait qu’il entrave le développement des forces productives. Au contraire, je pense que, d’un point de vue écologiste, la critique majeure à faire au capital, est qu’il repose sur une forme d’illimitation, qui pousse à produire toujours plus.
Mais c’est vrai que cela dépend en bonne partie de ce qu’on appelle « production » et « forces productives ».
Pour autant, je trouve problématique la façon dont Hardt et Negri (2009, p. 284-285) proposent de réhabiliter l’idée de croissance économique et de la remettre au cœur du projet d’émancipation (1).
Bien sûr, ils redéfinissent en profondeur le concept et ne parlent pas du tout de croissance du PIB. Mais insister sur une quelconque notion de croissance économique est un souci à un moment où la sobriété matérielle et énergétique devient vitale.
Comme le dit Giorgos Kallis (2019) :
« Quel que soit la façon de définir la ‘croissance économique’, cette notion ne peut renvoyer qu’à une hausse des standards de vie matérielle. Une hausse du standard de vie matérielle requière, en toute logique, plus de matériaux. Cela reste toujours vrai, que l’économie en question soit capitaliste, socialiste, anarchiste ou primitive. »
J’en arrive à la deuxième partie de ma présentation.
Je vais maintenant discuter l’approche de Pierre Dardot et Christian Laval, en pointer certaines limites, et chercher à dé-dramatiser l’opposition entre le commun comme principe politique et comme mode de production.
A) L’approche de Dardot et Laval et ses limites
1) Le commun comme principe politique
L’approche de Pierre Dardot et Christian Laval est largement inspirée de l’œuvre de Castoriadis et cherche à la renouveler.
Elle s’appuie d’abord sur sa philosophie du social-historique, qui cherche à penser le social sur un mode non déterministe, comme un processus de *création radicale+ qui puise sa source dans l’imaginaire.
Dardot et Laval s’appuient aussi sur la théorie politique de Castoriadis qui est construite autour d’un principe central : l’autonomie.
Le commun comme principe politique est largement une reformulation du principe d’autonomie.
Un principe est ce qui vient en premier et fonde tout le reste. Le commun est un principe politique au sens où il est sensé fonder et régir toute l’activité politique.
Plus qu’un principe politique, le commun est le principe de la politique : il est synonyme de la politique comprise dans un sens fort.
Dardot et Laval définissent la politique comme : « l’activité de délibération par laquelle les hommes s’efforcent de déterminer ensemble le juste, ainsi que la décision et l’action qui procèdent de cette activité collective ».
Les deux auteurs formulent le principe du commun de la façon suivante : « Il n’y a d’obligation qu’entre ceux qui participent à une même activité ou à une même tâche».
La co-activité est le fondement de l’obligation politique et donc de la légitimité des lois et règles co-produites. L’obligation politique ne découle donc d’aucune appartenance, que ce soit l’ethnie, la nation, ou même l’humanité.
Ensuite, si la co-obligation découle de la co-activité, elle ne peut pas avoir de source transcendante ou sacré.
L’obligation ne peut pas non plus procéder d’une autorité extérieure à l’activité. Cette idée renvoie à une formule de Castoriadis en faveur de l’autogestion : « Pas d’exécution des décisions sans part égale de tous dans la décision ».
Selon Dardot et Laval, cette idée découle du principe du commun. Ils proposent de la reformuler de cette façon : « seule la coparticipation à la décision produit une coobligation dans l’exécution de la décision » (2014, p. 86).
Le commun est donc conçu comme un principe politique d’autogouvernement, de démocratie radicale, qui a vocation à prévaloir à la fois dans la sphère politique et dans la sphère économique.
Il doit inspirer l’institution d’une multiplicité de communs, qui s’organiseraient à échelle mondiale dans une double fédération : une fédération des communs politiques et une fédération des communs socio-économiques.
2) Ambiguïtés de la formulation du principe politique
De plus en plus, j’ai l’impression que la formulation du principe du commun proposée par Pierre Dardot et Christian Laval a des faiblesses, ou des ambiguïtés.
Rappelons encore leur formulation : « Il n’y a d’obligation qu’entre ceux qui participent à une même activité ou à une même tâche ».
Le premier problème est que cette formule n’indique pas quel type de co-activité peut fonder la co-obligation.
La co-obligation découle-t-elle seulement d’une co-activité de délibération et décision collective ? Ou découle-t-elle de n’importe quelle activité : travailler ensemble, faire du sport, ou même aller au bar ?
Le deuxième problème, plus grave il me semble, tient à la permanence de la co- obligation face à l’intermittence de la co-activité.
Disons que nous sommes en assemblée générale et que nous prenons une décision. Celle-ci nous oblige puisque nous sommes pris dans la même activité de délibération.
Mais l’AG s’arrête et chacun rentre chez lui. Il n’y a plus de co-activité, donc pourquoi y aurait- il toujours co-obligation ?
Plus généralement, nous voulons instituer une multiplicité de communs. Faut-il que chacun participe en permanence à tous ces communs pour que leurs règles aient une quelconque force qui nous oblige ?
Le troisième problème tient au caractère ésotérique d’un principe qui se veut radicalement démocratique.
Le principe du commun me semble assez complexe et peu intuitif. Il est assez difficile d’expliquer à un non-expert, en quelques minutes, ce que signifie l’idée que la co-obligation repose sur la co-activité.
A l’inverse, le concept d’autonomie avait quelque chose de très intuitif, que chacun peut saisir facilement : se donner à soi-même sa propre loi.
3) Il faut un nouveau mode de production
Il y a quelques points où l’opposition entre commun comme principe politique et comme mode de production devrait probablement être relativisée.
D’abord, dans le livre « Le commun comme mode de production », les organisateurs de ce séminaire critiquent une phrase de Dardot et Laval qui affirme que le commun n’est pas un mode de production (2).
Si le commun n’est pas un mode de production, comment peut-il constituer une alternative au capitalisme, qui est lui, un mode de production ?
Il me semble que l’idée de Dardot et Laval est que le commun doit être compris comme un principe politique qui a vocation à s’étendre à la sphère économique, et donc, à inspirer un mode de production.
Le commun est donc un principe politique avant tout ; mais il doit inspirer l’institution d’un nouveau mode de production.
Ensuite, dans leur livre sur le « Commun », Dardot et Laval critiquent longuement l’analogie marxiste entre le passage du féodalisme au capitalisme et le passage du capitalisme au socialisme.
Je disais un peu plus tôt que cette analogie peut être intéressante, mais qu’elle ne constitue pas le schéma, universel et absolu, pour comprendre les grandes transformations historiques.
Pourtant, force est de constater que Dardot et Laval font revenir cette analogie par la fenêtre et la reprennent à leur compte lorsqu’ils parlent des travaux de Maxime Leroy sur le « droit prolétarien ».
En 1913, Maxime Leroy parle de l’ensemble des règles et des coutumes des organisations ouvrières (coopératives, syndicats, associations etc.), comme d’un droit prolétarien qui se développe d’une façon similaire au droit bourgeois avant 1789.
Dardot et Laval s’appuient sur cette idée pour penser un droit du commun (3). Cette analogie ne semble plus leur poser problème lorsqu’elle est centrée sur le droit plutôt que sur l’économie. Mais est-ce vraiment si différent ?
Leur façon de penser la transition vers le post-capitalisme n’est peut-être pas si différente de celle de Hardt et Negri après tout.
Elle articule deux choses : d’une part, des expérimentations institutionnelles qui se construisent ici et maintenant, à travers les luttes sociales ; d’autre part, l’idée d’une révolution libertaire qui viendrait les cristalliser et transformerait les institutions centrales de la société.
**B) Chantiers d’élaboration conceptuelle**
Je voudrais maintenant parler de trois chantiers d’élaboration conceptuelle.
Ces chantiers sont des points de divergence/nuance entre les approches du commun comme principe politique et du commun comme mode de production, que j’aimerais ouvrir à la discussion.
1) Public/privé/commun
Le premier chantier concerne l’articulation des concepts de public, privé et commun. Dans le livre « Le commun comme mode de production », l’articulation entre ces concepts est très claire et efficace, notamment dans le chapitre décrivant l’histoire sociale d’internet.
Il y a en gros trois pôles : la logique étatique et bureaucratique du public, la logique de la propriété privée qui fonde le marché et encourage la recherche du profit, et la logique démocratique et autogestionnaire du commun.
La façon dont Pierre Dardot et Christian Laval articulent ces concepts est très différente. Elle est issue de la distinction de Castoriadis entre trois sphères d’activités humaines : la sphère privée au sens stricte, la sphère publique-privée, et la sphère publique au sens stricte.
En Grèce antique, cette tripartition renvoie à celle entre l’oikos (le ménage), l’agora (place du marché), et l’ekklesia (assemblée des citoyens).
Dans un régime démocratique, ces trois sphères sont séparées : le pouvoir politique doit laisser une autonomie relative aux individus dans la sphère privée (le ménage) et dans la sphère publique-privée (il y a une certaine autonomie de la société civile par rapport à l’Etat).
A l’inverse, dans un régime totalitaire, la sphère publique-politique absorbe tout : l’Etat considère que tout ce que les individus font chez eux le concerne.
Aussi, Castoriadis considère que la démocratie peut être défini comme « le régime où la sphère publique devient vraiment et effectivement publique – c’est-à-dire effectivement ouvert à la participation de tous ».
Pour Dardot et Laval, le principe du commun a donc vocation à prévaloir à la fois dans la sphère publique et dans la sphère publique-privée, c’est-à-dire dans le domaine politique et dans le domaine socio-économique.
Clairement, les concepts de public, privé ou commun n’ont pas le même sens dans ces deux approches. Pourtant, elles sont toutes les deux très intéressantes.
Faut-il en choisir seulement une ou trouver un moyen de combiner les deux ?
2) Propriété et commun
Le deuxième chantier concerne l’articulation entre le commun et la propriété.
Faut-il instituer les communs par ou contre la propriété ? Les communs relèvent-ils de la propriété commune ou de la non-propriété ?
D’un côté, Pierre Dardot et Christian Laval opposent radicalement le commun et la propriété. Selon eux, il faut rejeter la notion de propriété et instituer les communs comme non- propriété.
De l’autre côté, de nombreux théoriciens des communs, à commencer par Elinor Ostrom, considèrent que les communs relèvent d’un régime de propriété collective ou commune.
Les auteurs du livre « Le commun comme mode de production » semblent se placer au- delà de la mêlée, en proposant une définition de la propriété commune qui a l’air de réconcilier les deux camps :
« La propriété commune désigne des rapports sociaux de propriété fondés sur l’usage, la mutualisation des ressources et l’inappropriabilité. » (p. 67)
Cette approche de la propriété commune est assez intéressante et permet d’aborder avec souplesse la diversité des outils juridiques mobilisés pour défendre les communs.
Malgré tout, je me demande si cette notion n’est pas une façon habile d’esquiver une question de fond.
Je n’ai pas d’idée définitive sur ce point et mes connaissances en droit sont modestes. Mais l’idée d’une propriété fondée sur l’inappropriabilité me semble un peu contradictoire.
3) Production et productivisme
Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai des réticences à associer l’idée d’émancipation sociale à celle de développement des forces productives.
Historiquement, c’est cette association qui a été le fondement du productivisme marxiste.
Et je trouve qu’il y a effectivement un reste de productivisme dans les travaux de Hardt et Negri. Pour autant, ce n’est pas du tout le cas de l’approche développée dans le livre « Le commun comme mode de production ». On peut citer notamment la valorisation des communs fonciers traditionnels, des savoirs indigènes, des mouvements paysans pour la souveraineté alimentaire, ou encore la promotion explicite d’une perspective « post-développementiste ».
A l’inverse, la notion d’autolimitation est au cœur de la philosophie de Castoriadis.
Elle permet de poser l’objectif d’une autolimitation de la production et même de décroissance.
Or, aujourd’hui, nos systèmes économiques consomment trop de matériaux et d’énergie pour être soutenables : il faut donc planifier la décroissance de cette consommation énergétique et matérielle.
Cette exigence colle mal avec la valorisation du développement des forces productives.
Je ne suis pas certain que la différence entre les deux approches soit si radicale sur ces questions. Il me semble qu’elle tient surtout à la façon dont on définit des concepts comme la production, la reproduction, les forces productives, la productivité etc.
J’aimerai donc retravailler ces notions, en m’appuyant notamment sur les travaux de l’économiste décroissant Giorgos Kallis.
Il me semble que le point central du problème est soulevé dans le livre « Le commun comme mode de production » :
« Dans les productions de l’humain par l’humain, l’efficacité est avant tout qualitative et le concept même de productivité perd une grande partie de son sens » (p. 65).
C’est tout à fait vrai. Dans la santé, l’éducation, le soin, la recherche, ou même l’art et l’artisanat, la recherche de gains de productivité est contre-productive.
Il me semble qu’il y a là une des raisons essentielles de la stagnation des économies et du ralentissement des gains de productivité.
Cela serait encore plus vrai dans un système post-capitaliste basé sur le commun. Dans ce contexte, je trouve un peu inadaptées les notions de développement des forces productives, de productivité biopolitique, ou de croissance. Ces termes renvoient largement à une approche quantitative et industrialiste, qui repose sur les gains de productivité.
Pour finir, je vais tenter de faire une proposition théorique, qui n’est vraiment qu’une ébauche, une piste à ce stade.
Je me demande si la solution ne serait pas de proposer une reformulation du principe politique du commun, qui intégrerait une part de l’apport post-opéraïste.
La définition du commun comme principe politique serait construite autour de trois éléments : l’autonomie, l’inappropriabilité, et la communication.
Le premier élément serait un principe d’autonomie ou d’autogouvernement, qui serait pleinement issu de la philosophie de Castoriadis.
Le deuxième élément relèverait de l’inappropriabilité et chercherait surtout à intégrer l’apport de Pierre Dardot et Christian Laval.
D’une part, cet élément renvoie à une exigence de mise en commun et de partage des ressources, à une exigence d’égalité économique, qui répond mieux au contexte néolibéral. Cette exigence était moins centrale dans la philosophie de Castoriadis, qui s’est surtout construit comme une critique libertaire de la bureaucratie.
D’autre part, cet élément renvoie à la critique de la propriété développée par Dardot et Laval, de la figure du propriétaire conçu comme sujet ayant une maitrise et un droit absolu sur un objet.
Cette critique montre à la fois les impasses de la propriété privée et de la propriété publique, et trace un parallèle entre la propriété et la souveraineté.
A l’inverse, un commun est de l’ordre de l’inappropriable. Cela est lié au fait que les communs, avant d’être des ressources partagées, sont surtout des institutions d’autogouvernement dédiées à l’usage collective d’une ressource.
L’inappropriabilité d’un commun ne concerne donc pas seulement les ressources, mais surtout l’activité collective qui les prend en charge.
Le troisième élément de définition du commun comme principe politique serait une certaine conception de la communication.
Celle-ci permettrait d’intégrer au moins une partie des analyses post-opéraïstes du General Intellect et de l’économie fondée sur la connaissance.
Il s’agit d’insister sur le fait que le développement d’une intelligence diffuse et des technologies numériques, brouille largement les frontières des organisations.
Le travail cognitif ne se fait pas exclusivement dans des lieux bien circonscrits, dans des organisations fermées, qu’elles soient capitalistes ou communalistes.
Cette dynamique productive socialement diffuse est contraire à la logique propriétaire : la propriété ici, incarne les frontières des organisations productives.
Les institutions d’autogouvernement, les communs, sont donc susceptibles de nouer des liens, d’échanger, de recomposer leurs frontières au fur et à mesure.
La communication renvoie ici à une ouverture relative et toujours renégociable des organisations économiques et politiques.
Enfin, il s’agit aussi de reconnaitre qu’une économie basée sur la communication et la connaissance facilite l’autogestion. L’autogestion des travailleurs cognitifs n’est pas un déjà- là, elle ne surgit pas spontanément, mais elle est surement plus facile à réaliser que l’autogestion ouvrière.
Voilà donc trois éléments qui pourraient permettre de redéfinir le commun comme principe politique. Un principe politique qui, en s’étendant à la sphère socio-économique, devrait être le fondement d’un mode de production post-capitaliste.
Notes :
(1) «It forcefully emphasizes the theme of the tendency of capitalist development, of the necessity of its re- appropriation and disruption. On this basis then it advances the construction of a communist program. These are strong legs on which to walk forward.” (Negri – Reflections on Accelerate 2014)
(2) « En raison de son caractère de principe politique, le commun ne constitue pas non plus un nouveau ‘mode de production’ ou encore un ‘tiers’ s’interposant entre le marché et l’État pour former un troisième secteur de l’économie à côté du privé et du public » (Dardot et Laval, 2014, p. 531).
(3)« Ce droit prolétarien est en effet comparable au droit bourgeois d’avant 1789. Les solidarités ouvrières qu’il institue ne sont pas d’une autre nature que les solidarités communales qui ont été un élément déterminant d’affirmation et de puissance de la bourgeoisie contre la féodalité » (Dardot et Laval, 2014, p. 389).
Ludovic Bonduel est docteur en science politique de l’université LUISS Guido Carli (Rome), enseignant à l’Institut Catholique de Paris et chercheur affilié au Centre d’Etudes sur les Médias, les Technologies et l’Internationalisation (CEMTI) de l’Université Paris 8. Ses recherches portent sur les communs numériques et, plus largement, sur les conflits politiques et sociaux associés à l’économie numérique : https://www.cemti.fr/equipe/ludovic-bonduel/
05/02/2025